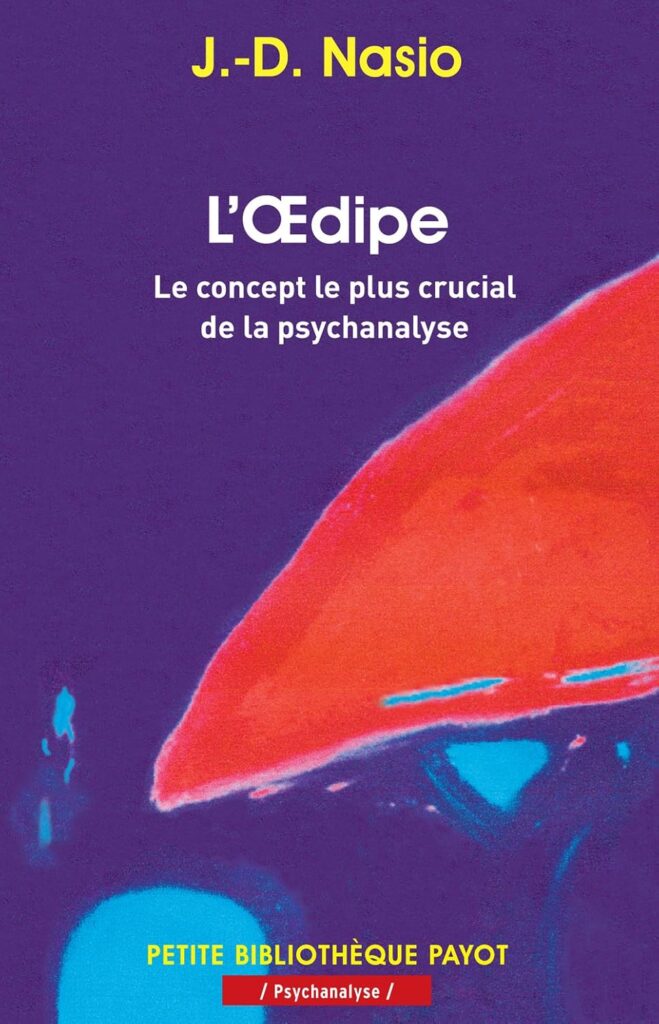Inconscient et sexualité psychique de l’enfant
Le complexe d’Œdipe, en psychanalyse, est inspiré de l’un des récits de la mythologie grecque. En psychanalyse, il est, selon l’auteur, le fruit d’un fantasme infantile qui agit dans l’inconscient. L’Œdipe n’est pas une affaire de sentiments, mais de corps, de désirs, de fantasmes et de plaisirs. Il fait référence à la sexualité psychique de l’enfant, et sa façon de résoudre l’Œdipe va marquer les traits de sa personnalité future. L’Œdipe, c’est la sexualisation, puis la désexualisation (inconscientes), des parents.
L’apparition du complexe d’Œdipe au stade phallique
Ce complexe, apparaît vers l’âge de 4 ans, à une étape du développement de l’enfant nommée « stade phallique », parce qu’à ce stade, le pénis est considéré par le petit garçon comme son objet le plus précieux le plus valorisant et c’est la partie du corps la plus investie ; il est source de fierté et de narcissisme. Il est le représentant du pouvoir, il représente ce que la psychanalyse nomme le « phallus ». Tous les enfants pensent que c’est un attribut universel et que tous les êtres du monde sont dotés d’un puissant phallus et la petite fille s’imagine qu’elle en possède un également. Le phallus n’est pas synonyme de « pénis » ; en psychanalyse, il désigne ce qui est valorisé, l’objet précieux, aimé, ce peut être une personne, une entreprise, une position sociale, un projet, ce à quoi nous tenons le plus, ou ce qui manque.
L’angoisse de perdre le phallus
Toutefois, cette idolâtrie du phallus engendre également l’angoisse de le perdre. L’enfant ayant déjà vécu des pertes, comme celle du sein maternel (stade oral), du doudou, du « caca » qui se détache de lui (stade anal), il redoute de perdre le phallus. Cette crainte est à l’origine de la formation du « fantasme de castration » chez le garçon, qui équivaut au « fantasme de douleur de privation » chez la fille.
Tout fier de sa puissance et doté d’un réservoir pulsionnel débordant, le petit enfant est animé d’un élan sensuel envers ses parents, il recherche le contact de l’autre, et les corps qui sont à sa portée de sa main sont ceux de ses parents, qui entretiennent cet élan par la tendresse, les caresses, les bisous et canalisent ses pulsions. Les marques de tendresses et les caresses de la maman éveillent la pulsion sexuelle de l’enfant.
Juan-David Nasio précise que le désir lié à l’Œdipe n’a rien à voir avec les abus sexuels commis par certains pères sur leurs enfants ; le désir œdipien relève d’un désir de « retour à l’état originel de béatitude intra-utérine », un « désir de fusion avec notre terre nourricière ».
Les trois désirs fondamentaux chez l’être masculin
Selon l’auteur, les trois désirs fondamentaux présents chez le garçon et chez tout être masculin sont :
-Le désir de posséder sexuellement le corps de l’autre.
Il peut se traduire chez l’enfant par le fait de s’exhiber, jouer au docteur ou au papa et à la maman, faire le pitre, mordre le corps de l’autre.
-Le désir d’être possédé par le corps de l’autre.
Par exemple, l’enfant fait son petit numéro de « charme » à un adulte, pour le séduire, attirer son attention.
-Le désir de supprimer le corps de l’autre.
Ce peut être, par exemple, le garçon qui joue au chef de famille en l’absence de son père.
JD Nasio considère l’Œdipe comme « la première névrose de croissance de l’être humain » ; L’enfant se sent tiraillé entre le plaisir et la peur d’être puni, avec l’angoisse de castration qui en résulte. Une deuxième secousse œdipienne survient à l’adolescence.
Les variantes du fantasme de castration
Chez le petit garçon naît le fantasme d’écarter le père pour avoir sa mère pour lui seul, mais il a peur de la punition de la part du père, considéré comme l’agent castrateur. Il existe trois variantes du fantasme de castration :
-Le père est l’interdicteur que l’on craint.
-Le père est l’abuseur que l’on craint.
-Le père est le rival que l’on craint. C’est cette angoisse de castration, qui est une menace imaginaire et non une réalité, qui précipite la résolution du Complexe d’Œdipe. Le petit garçon renonce à ses désirs, et se soumet à la loi de l’interdit de l’inceste ; les quatre motions que sont : l’amour, la haine, la crainte et le désir pour le père, vont définir le surmoi du garçon. Il quitte sa mère, garde son pénis et dirige son désir vers d’autres « objets », cette fois légitimes
Formation du Surmoi lors de la résolution du Complexe d’Œdipe
Par conséquent, le narcissisme et les pulsions d’autoconservation et de puissance l’emportent sur les pulsions sexuelles. Lors de la résolution du Complexe d’Œdipe se forme l’instance psychique nommée « surmoi » (notre « père psychique »), par laquelle il va intégrer les interdits parentaux qu’il appliquera lui-même et il commencera à se forger peu à peu une identité sexuelle.
Pour la petite fille, au début, la mère est toute puissante, c’est elle qui a le phallus, la petite fille veut la posséder. Lorsqu’elle découvre qu’elle ne possède pas le phallus, elle se sent dépossédée et a l’impression d’avoir été trompée par sa mère, c’est le temps de la solitude, elle éprouve la « douleur du fantasme de privation », qui ébranle son narcissisme ; alors, la fille se détourne de sa mère et entre dans l’Œdipe. Elle se tourne vers le « père merveilleux, détenteur du phallus », elle veut être la femme de l’homme aimé (« quand je serai grande, je me marierai avec papa », entend-on dire la petite fille). Le père refuse de considérer la fille comme son phallus, ne veut pas d’elle comme femme. La fille décide alors d’être lui, elle s’identifie à la personne du père ; après avoir tué le père fantasmé, elle le ressuscite comme modèle d’identification et s’ouvre à d’autres partenaires de vie. Il existe donc deux identifications chez la petite fille : à la féminité de la mère et à la virilité du père.
Selon JD Nasio, « l’Œdipe est un fantasme de séduction à la base de l’identité sexuelle de tout homme ou femme », c’est « l’expérience d’une perte et d’un deuil, celui des parents fantasmés en tant que partenaires sexuels ». Il ajoute que les conflits rencontrés avec notre entourage au cours de notre vie sont le prolongement de ce qui a été vécu au moment du Complexe d’Œdipe.
Causes les plus fréquentes de certains troubles psychologiques
L’auteur nous explique les causes les plus fréquentes de certains troubles psychologiques observés à l’âge adulte :
-La névrose : résulte d’un Œdipe mal refoulé ou d’une sexualité infantile perturbée : inhibée, hypertrophiée, ou arrêtée dans sa maturation ; il y a alors réactivation de l’Œdipe à l’âge adulte, sous forme de symptômes névrotiques (trouble obsessionnel, phobique, etc.). JD Nasio affirme également retrouver, chez de nombreuses personnes souffrant de névrose, des relations infantiles conflictuelles avec le parent de même sexe. La névrose est, de ce point de vue, une pathologie du narcissisme.
La névrose est définie par JD Nasio comme « le retour compulsif d’un fantasme infantile d’angoisse de castration ». C’est le père qui incarne toujours le personnage principal des fantasmes traumatiques à l’origine des névroses.
-La phobie : le patient phobique a souvent vécu (réellement ou dans l’imaginaire) un abandon pendant l’enfance. La phobie est une projection de l’angoisse de castration sur le monde extérieur.
-L’hystérie : la personnalité hystérique résulterait d’une excitation (réelle ou imaginaire) vécue au cours de l’enfance par un adulte séducteur. L’hystérie est une rébellion.
-La personnalité obsessionnelle : elle concerne souvent des personnes qui se sont trouvées impuissantes, craignant les représailles du père pour une faute qu’elles ignoraient. Elles ont tendance plus tard à répéter, de façon compulsive, la même situation dans laquelle l’impact traumatique a été ressenti. L’obsession est un déplacement.
Les trois temps de l’Œdipe chez Jacques Lacan
Le Complexe d’Œdipe a été découvert et élaboré par Freud à la suite de séances effectuées avec ses patients, révélant des souvenirs d’enfance à caractère sexuel, des scènes de séduction sexuelle vécues réellement ou dans leur imaginaire.
Selon Jacques Lacan (1901-1981), psychiatre et psychanalyste français, le processus de l’Œdipe s’effectue en trois temps :
-1er temps de l’Œdipe : le père représente la figure abstraite de la Loi : c’est le père symbolique.
-2ème temps de l’Œdipe : c’est la personne réelle du père qui compte : le père réel, celui qui fait respecter la Loi.
-3ème temps de l’Œdipe : le rival, frustrateur, détenteur du phallus (la mère) : le père imaginaire, qui est jalousé et contesté.
Puisque le garçon ne peut pas avoir le phallus, l’objet (la mère), il s’identifie au détenteur de l’objet, qui est le père. Au cours de sa traversée de l’Œdipe, l’enfant va donc rencontrer les trois figures du père : symbolique, réelle et imaginaire.
L’auteur fournit dans son ouvrage des tableaux explicatifs et comparatifs illustrant la théorie œdipienne s’appliquant au garçon et à la fille (vue générale, logique de l’Œdipe du garçon, logique de l’Œdipe de la fille,) le fantasme d’angoisse de castration et types de névrose, les trois types de manque dans l’Œdipe, les positions masculines et féminine concernant la sexualité, le comportement vis-à-vis du partenaire amoureux, le narcissisme, l’attitude sociale, la volonté.
Le tableau intitulé « Vue générale de l’Œdipe », page 24 du livre, est joint à ce résumé.
À propos de l’auteur :
Juan David Nasio, né en 1942, en Argentine, a suivi des études de médecine à Buenos Aires et s’est spécialisé en psychiatrie. En 1969, il est venu en France pour suivre l’enseignement de Jacques Lacan. Il a été chargé de cours à L’Université Paris VII durant 30 ans et a tenu un séminaire dans le cadre de l’Ecole freudienne de Paris de 1977 à 1980. En 1986, il a fondé les Séminaires psychanalytiques de Paris. Il est l’auteur de 35 ouvrages traduits en 14 langues. Il intervient sur France Inter (station de radio), dans l’émission « l’Inconscient », un podcast interactif, au cours duquel il répond aux questions des auditeurs.